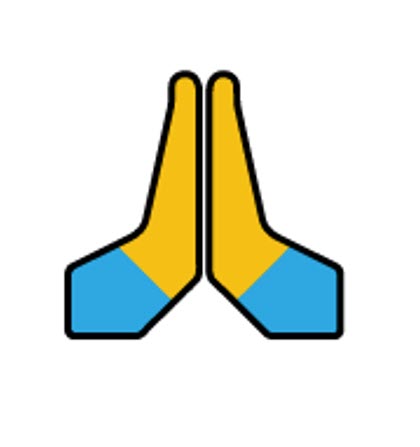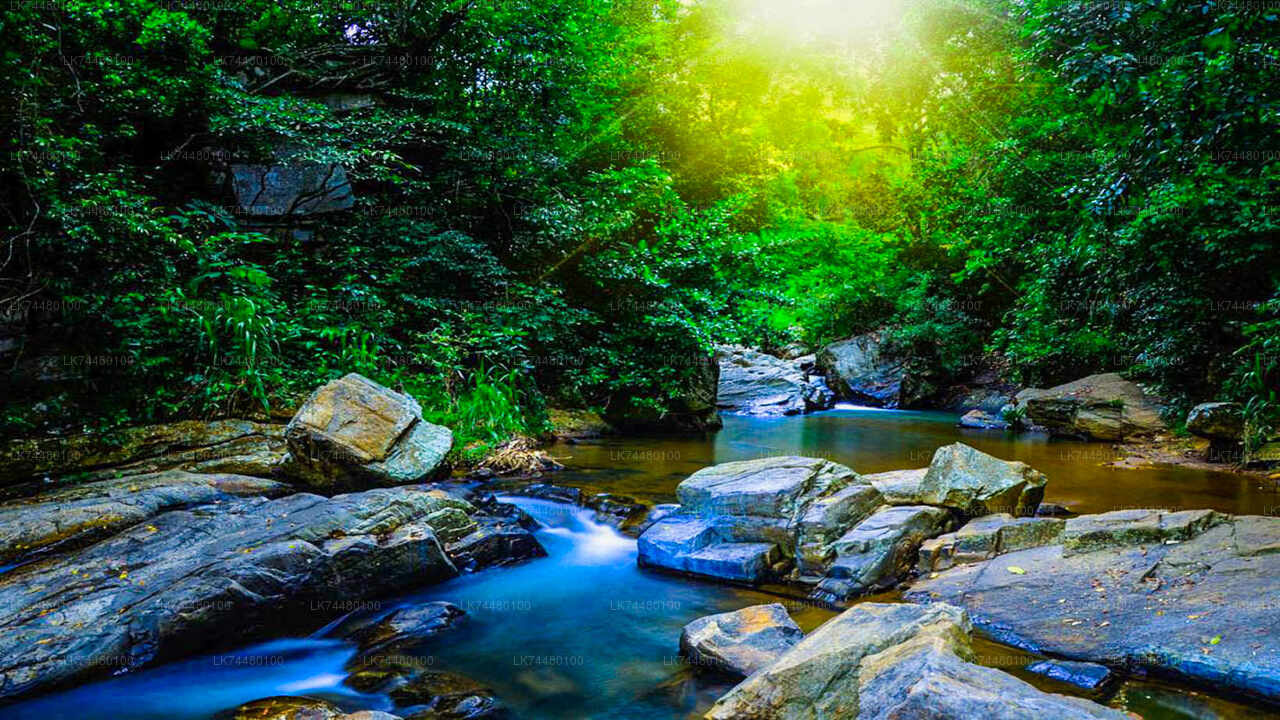Ville de Ratnapura
Ratnapura, surnommée la « Cité des Gemmes » du Sri Lanka, est un centre d'extraction et de commerce de pierres précieuses situé au sud-ouest de l'île. Elle se trouve sur les rives de la rivière Kalu, au pied du Pic d'Adam, entourée de paysages luxuriants et constitue un point de rencontre pour les voyageurs en quête d'expériences culturelles et des célèbres pierres précieuses de la région.
Homme de Balangoda

Le Sri Lanka est considéré comme un point central sur la route de l’évolution humaine. Les grottes de Batadombalena à Ratnapura contenaient des preuves importantes concernant l’évolution humaine, y compris un crâne humain préhistorique. Des recherches approfondies et des expéditions ont révélé de nouveaux détails sur le mode de vie de nos ancêtres, marquant le début d’une nouvelle ère dans l’étude de l’évolution humaine.
L’Homme de Balangoda (බලංගොඩ මානවයා), Homo sapiens balangodensis, est le premier humain connu ayant vécu durant l’ère mésolithique. Selon les sources, un squelette a été découvert sur un site archéologique près de Balangoda. Il doit son nom au lieu où ses restes ont été retrouvés.
Selon les preuves trouvées dans des grottes et autres sites, l’Homme de Balangoda serait apparu il y a environ 38 000 ans, et des restes récemment découverts ont été datés de 30 000 ans. C’est la première preuve de la présence d’humains modernes anatomiquement développés en Asie du Sud à cette époque. Des artefacts culturels, notamment des microlithes géométriques datés de 28 500 ans, furent retrouvés avec le squelette. Les plus anciennes preuves d’utilisation d’outils en pierre proviennent de ce site et de quelques autres en Afrique.
Homme de Balangoda
L’Homme de Balangoda était de grande taille et a vécu il y a des dizaines de milliers d’années. Cet hominidé archaïque mesurait environ 174 cm (les femmes environ 166 cm). Des recherches approfondies ont permis d’en apprendre davantage sur le mode de vie de nos ancêtres.
Selon les études, les premiers humains avaient un nez enfoncé, des arcades sourcilières prononcées, un crâne épais, de grandes dents, un cou court et une mâchoire robuste. Les squelettes trouvés dans les grottes sont vieux de plus de 16 000 ans. Leur analyse révèle une forte compatibilité biologique.
Les recherches suggèrent également une connexion naturelle avec la population indigène moderne appelée les Veddas. Une découverte importante indique que l’Homme de Balangoda, initialement installé dans les hautes terres, a ensuite migré vers les plaines et est passé du statut de chasseur à celui d’agriculteur.
À Bellanbandi Palassa, des haches à main méso-néolithiques fabriquées à partir d’os de jambe d’éléphants ont été découvertes. Des poignards ou outils façonnés à partir de bois de cerf ont également été trouvés, en plus des microlithes. D’autres sites similaires montrent un usage abondant d’ocre, de chiens domestiqués, de zones funéraires ainsi que l’utilisation intensive du feu.
Parmi les autres découvertes figurent des ornements personnels et des restes d’animaux utilisés pour la nourriture, tels que des fragments de mollusques, des os de poissons, des perles fabriquées à partir de vertèbres de requin, des pendentifs en coquillages, des outils en os polis, ainsi que des restes carbonisés de bananes sauvages et de fruits à pain.
La fréquence des perles en coquillages marins, des dents de requins et des objets similaires suggère que les habitants des grottes étaient en contact avec la côte située à environ 40 kilomètres. Des traces provenant de la grotte de Beli Lena montrent le transport de sel depuis le littoral vers l’intérieur.
Une grande mobilité, l’utilisation des ressources de la forêt tropicale et la capacité d’adaptation aux changements climatiques coïncident avec la tradition microlithique. Selon les chercheurs, les microlithes géométriques trouvés sur le site de Horton Plains indiquent que la région était habitée durant la période mésolithique.
Les chasseurs-cueilleurs préhistoriques installés dans des abris rocheux visitaient probablement Horton Plains pour chasser et récolter des céréales sauvages dans le cadre de leur cycle annuel d’alimentation. Horton Plains semble avoir été un simple campement temporaire, et non un établissement permanent.
Plusieurs ressources végétales de la forêt tropicale, telles que le fruit à pain sauvage, la banane et les noix de canarium, ont été utilisées à la fin du Pléistocène et au début de l’Holocène. Dans certaines régions, le passage du mode de vie de chasseur-cueilleur à l’agriculture a commencé à cette période. Il est possible que des pratiques de brûlis aient aidé à exploiter les ressources naturelles et à favoriser progressivement la culture du riz.
Histoire de l’Homme de Balangoda
Le comportement humain moderne et l’expansion des premiers humains à travers l’Ancien Monde peuvent être retracés grâce aux découvertes archéologiques du Pléistocène supérieur en Asie du Sud. Avant que le détroit de Palk et le Pont d’Adam soient submergés il y a environ 7000 ans, les populations humaines et animales pouvaient voyager entre le sous-continent indien et le Sri Lanka grâce à un pont terrestre naturel.
Des paléontologues ont découvert des restes de faune préhistorique dans le district de Hambantota datant d'environ 125 000 ans, près de Bundala. Des outils en quartz et en silex ont également été découverts, probablement datant du Paléolithique moyen. Certains scientifiques pensent que des humains préhistoriques vivaient au Sri Lanka il y a 500 000 ans — voire 300 000 ans.
Il existe des preuves solides d’un ancien peuplement à travers toute l’Asie du Sud. En Inde, un crâne daté de 200 000 ans a été découvert. Bien qu’il ne soit pas considéré comme un homme moderne, il fut nommé « Homme de Narmada », le premier témoignage confirmant la présence d’humains en Asie du Sud.
Après sa découverte, des controverses sont apparues quant à sa classification taxonomique. En 1955, Deraniyagala proposa le nom « Homo sapiens balangodensis ».
Preuves de l’existence de l’Homme de Balangoda
Les archives fossiles de l’île datant d’environ 40 000 ans sont bien plus complètes que celles des périodes précédentes. Les premières preuves d’humains modernes anatomiquement identiques en Asie du Sud proviennent de cette époque.
La grotte Fa Hien, située à Kalutara, contient parmi les plus anciens fossiles humains. Elle était utilisée par des moines chinois voyageant pour obtenir des écritures bouddhistes. Des analyses au carbone ont montré qu’elle fut occupée entre 34 000 et 5 400 ans.
Dans la région de Sri Pada (Pic d’Adam), le système de grottes de Batadomba Lena a révélé de nombreux artefacts anciens précieux.
Lors des premières fouilles dans les années 1930, des ossements d’un enfant et de plusieurs adultes furent découverts. En 1981, de nouvelles fouilles mirent au jour davantage de restes humains datant de 16 000 ans, ainsi que des microlithes datés de 28 500 ans.
Des microlithes géométriques trouvés dans les grottes de Kitulgala et Beli Lena et sur deux sites côtiers de Bundala comptent parmi les plus anciens au monde, équivalents à ceux trouvés en Afrique. En Inde, des outils similaires ont été utilisés vers 24 500 ans.
Des découvertes dans Sabaragamuwa et Uva montrent que cette technologie a perduré jusqu’au VIᵉ siècle av. J.-C., avant d’être remplacée par de plus grands outils en pierre.
Des fragments de squelettes humains ont également été découverts dans la grotte de Beli Lena et à Bellanbandi Palassa. Les analyses indiquent que l’île était habitée sur une très longue période.
Lien avec la population Vedda
Les archives historiques décrivent le peuple autochtone du Sri Lanka, les Veddas, comme des chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes naturelles. Ils échangeaient leur miel et leur gibier contre des pointes de flèches et de lances en métal avec les villages voisins. Selon Deraniyagala, l’Homme de Balangoda serait l’ancêtre direct des Veddas et de certains groupes cinghalais.
Certains Veddas se sont ensuite intégrés dans les villages ou ont participé à des opérations militaires sous le royaume de Kandy.
Les Veddas présentent une taille plus petite, un crâne plus robuste, des dents plus grandes et une plus grande diversité crânienne que les autres groupes ethniques de la région. Les études génétiques montrent que leur ADN mitochondrial est plus proche de celui des Cinghalais et des Tamouls sri-lankais que de celui des Tamouls indiens.
Il est également probable que certains traits génétiques de l’Homme de Balangoda subsistent encore aujourd’hui au Sri Lanka.
L’Homme de Balangoda aurait vécu jusqu’en 500 av. J.-C. et peut-être plus longtemps dans les forêts tropicales. Avec l’arrivée des colons indiens, leur population diminua progressivement.